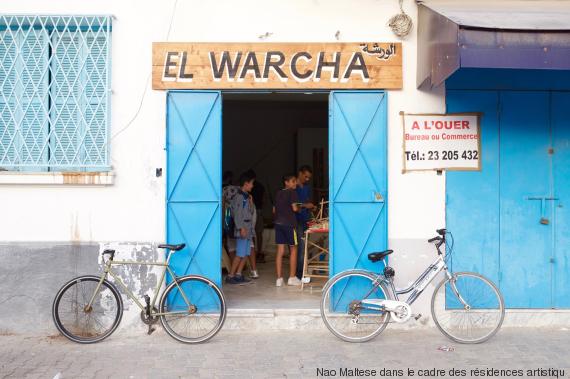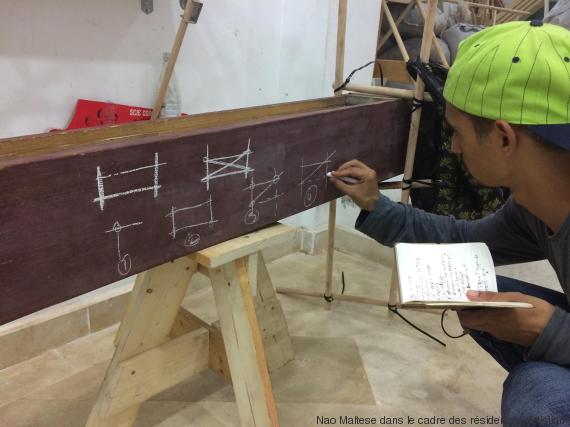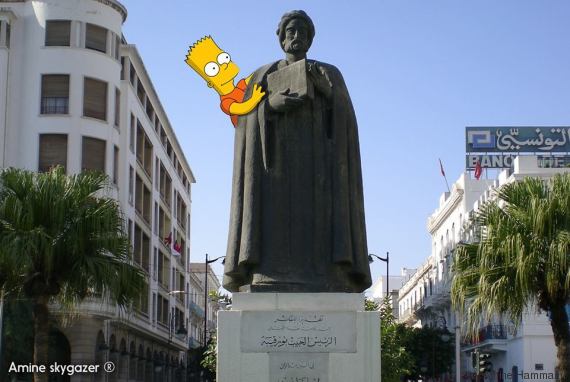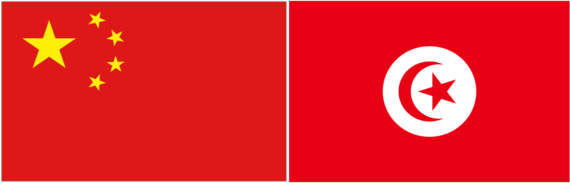Les médecins tunisiens ont décrété, jeudi 23 mars, "journée de colère" pour protester contre les arrestations et condamnations de collègues pour "erreur médicale", des affaires qui ont agité l'opinion publique ces derniers mois.
Plus de 200 professionnels de la santé, publique et privée, ont manifesté devant le ministère de la Santé pour, notamment, réclamer une loi protégeant les médecins, selon un journaliste de l'AFP sur place.
Une grève générale à l'appel du Conseil national de l'ordre des médecins a été décrétée mercredi et jeudi.
Mercredi soir, un médecin anesthésiste et un infirmier, arrêtés en février suite au décès d'un patient dans une clinique de Gabès (sud), ont été condamnés par la justice, respectivement à un an et six mois de prison pour "homicide involontaire commis ou causé par maladresse, imprudence, négligence ou inattention", a-t-on appris auprès du tribunal de Gabès.
Leur arrestation avait été vivement critiquée par le corps médical, qui avait réclamé leur libération immédiate et dénoncé leur arrestation préventive avant que l'erreur médicale n'ait été prouvée.
Le jugement à leur encontre est "scandaleux", a dit à l'AFP Habiba Mizouni, secrétaire générale du syndicat national des médecins dentistes.
D'autant plus qu'ils travaillaient "dans une région sous-médicalisée, sinistrée d'un point de vue médical", a-t-elle ajouté, au milieu des nombreux médecins présents lors de la manifestation.
"En Tunisie, il n'y a pas de loi qui définisse la responsabilité médicale à ce jour (...). Cette loi tarde à venir", a renchéri Mohamed Ayed, secrétaire général du syndicat tunisien des médecins libéraux.
Début février, une grève générale dans le secteur privé et public a été observée à la suite de l'interpellation d'une médecin résidente, également après des soupçons d'erreur médicale sur un nouveau-né.
L'affaire avait fait polémique et de nombreux Tunisiens avaient accusé les médecins de croire que leur profession était "au-dessus des lois".
De leur côté, les médecins dénoncent leur "diabolisation" sur fond de dégradation générale du système de santé publique en Tunisie, autrefois un fleuron du pays.
Plus de 200 professionnels de la santé, publique et privée, ont manifesté devant le ministère de la Santé pour, notamment, réclamer une loi protégeant les médecins, selon un journaliste de l'AFP sur place.
Une grève générale à l'appel du Conseil national de l'ordre des médecins a été décrétée mercredi et jeudi.
Mercredi soir, un médecin anesthésiste et un infirmier, arrêtés en février suite au décès d'un patient dans une clinique de Gabès (sud), ont été condamnés par la justice, respectivement à un an et six mois de prison pour "homicide involontaire commis ou causé par maladresse, imprudence, négligence ou inattention", a-t-on appris auprès du tribunal de Gabès.
LIRE AUSSI: Dr. Slim Hamrouni écope d'une peine d'un an de prison: Un jugement "inattendu" estime son avocat
Leur arrestation avait été vivement critiquée par le corps médical, qui avait réclamé leur libération immédiate et dénoncé leur arrestation préventive avant que l'erreur médicale n'ait été prouvée.
Le jugement à leur encontre est "scandaleux", a dit à l'AFP Habiba Mizouni, secrétaire générale du syndicat national des médecins dentistes.
D'autant plus qu'ils travaillaient "dans une région sous-médicalisée, sinistrée d'un point de vue médical", a-t-elle ajouté, au milieu des nombreux médecins présents lors de la manifestation.
"En Tunisie, il n'y a pas de loi qui définisse la responsabilité médicale à ce jour (...). Cette loi tarde à venir", a renchéri Mohamed Ayed, secrétaire général du syndicat tunisien des médecins libéraux.
Début février, une grève générale dans le secteur privé et public a été observée à la suite de l'interpellation d'une médecin résidente, également après des soupçons d'erreur médicale sur un nouveau-né.
L'affaire avait fait polémique et de nombreux Tunisiens avaient accusé les médecins de croire que leur profession était "au-dessus des lois".
De leur côté, les médecins dénoncent leur "diabolisation" sur fond de dégradation générale du système de santé publique en Tunisie, autrefois un fleuron du pays.
LIRE AUSSI:
Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.