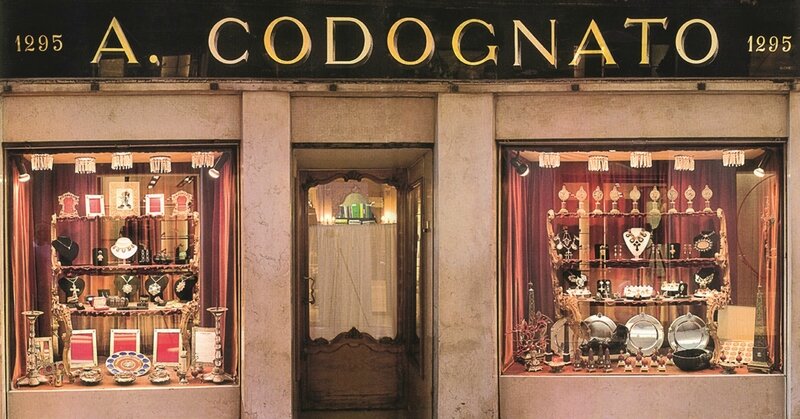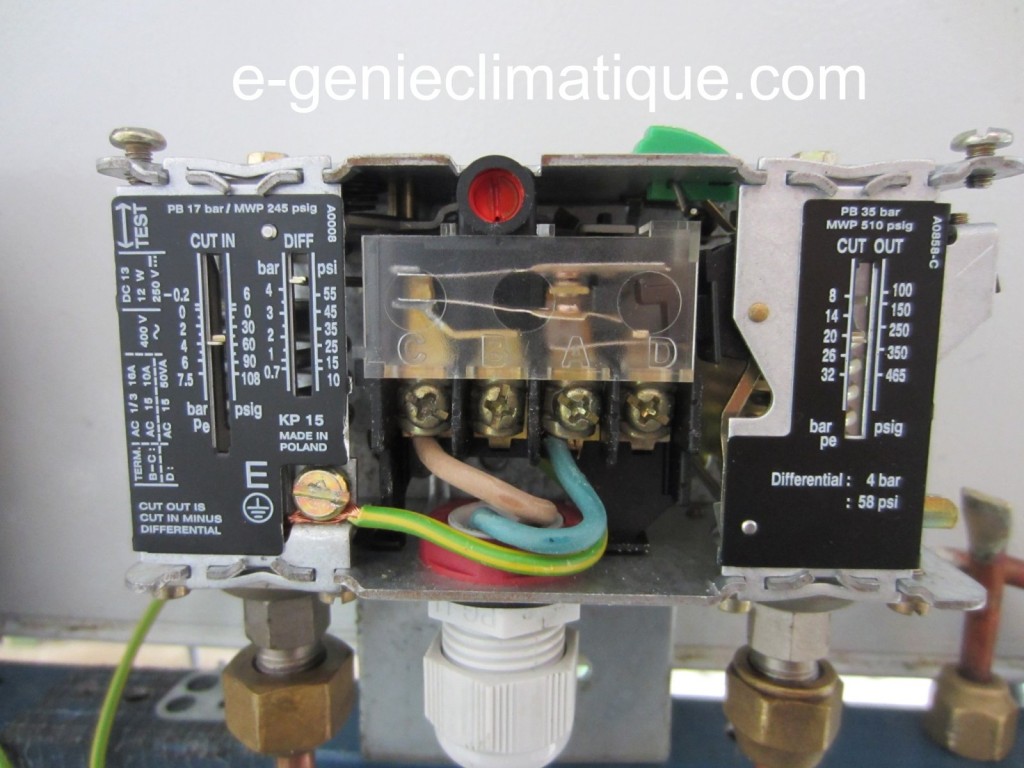On aurait pu attendre de cet ouvrage qu'il présente au lecteur une image en conformité avec la richesse du paysage politique tunisien et avec l'originalité de la méthode participative adoptée tout au long d'un processus qui s'est poursuivi du 16 février 2012 au 27 janvier 2014. C'était une belle occasion de retracer l'histoire d'une transition politique souvent citée comme un exemple de réussite.
Malheureusement on peut regretter, dans cette initiative prometteuse au départ, certaines lacunes dans le choix des contributeurs, certains manquements dans les thèmes traités qui dénotent une absence d'objectivité voire une sorte de parti pris ... Tout cela a été confirmé lors de la célébration, sous le haut patronage du Président de la République, de la sortie de cet ouvrage d'où la majorité des acteurs essentiels de cette période ont été exclus à l'exemple des nombreux députés et conseillers de l'ANC.
Cela m'amène ici, en tant que président de l'ANC, à livrer au lecteur ma propre contribution à l'écriture de cette transition politique, qui a constitué un tournant essentiel dans notre histoire récente.
"Par fierté pour la lutte de notre peuple afin d'accéder à l'indépendance et à la construction de l'État et, par la suite, pour se débarrasser de la tyrannie, répondant ainsi à sa libre volonté et concrétisant les objectifs de la révolution, de la liberté et de la dignité du 17 Décembre 2010 - 14 Janvier 2011 ; par fidélité au sang versé par nos valeureux martyrs et aux sacrifices des Tunisiens et Tunisiennes au fil des générations ; pour une rupture définitive avec l'injustice, la corruption et la tyrannie." Extrait du Préambule de la Constitution Tunisienne du 27 janvier 2014
Chaque fois que la Tunisie, sa révolution et sa transition vers la démocratie sont évoquées dans le monde occidental, les observateurs ne tarissent pas d'éloges et les épithètes les plus forts sont avancés: Success story, révolution pacifique, modèle tunisien, exception tunisienne, ...
Initiatrice de ce qu'il est convenu d'appeler le "printemps arabe", la Tunisie se distingue en effet par un processus de transition vers la démocratie qui a su évoluer positivement par étapes avec un nombre relativement réduit de pertes humaines. Comparativement avec les autres pays arabes qui ont eux aussi connu une vague de changements, les Tunisiens ont réussi une meilleure gestion de leurs différends pratiquant une méthode de recherche du consensus qui leur a épargné tant les affres du chaos et de la guerre civile, tel que cela s'est passé en Libye, en Syrie, au Yémen, en Irak, que le retour brutal à l'autoritarisme comme c'est le cas en Égypte.
Cette élaboration du processus de transition pendant les quatre années qui ont suivi la Révolution tunisienne a été marquée par un jeu particulièrement complexe d'avancées et de recul, mais plusieurs éléments clefs, convergeant tous vers le consensus, lui ont donné son originalité:
- Les forces politiques, syndicales et associatives qui ont pu assumer le relai de la Révolution,
- La "Troïka" qui a constitué un accord gouvernemental des trois principaux partis représentés à l'Assemblée Nationale Constituante (ANC), l'un islamiste d'Ennadha fortement majoritaire, les deux autres progressistes: le CPR présidé par Moncef Marzouki et Ettakatol dont je suis le secrétaire général,
- L'ANC qui a travaillé avec assiduité à la mise en place des institutions et à l'élaboration d'une Constitution conforme à l'esprit de la Révolution,
- L'instauration d'un Dialogue national qui a permis, sous la houlette de quatre organisations crédibles de la société civile, de gérer la crise de l'été 2013, de poursuivre le consensus favorable à l'application du nouveau cadre politique avec la tenue d'élections législatives et présidentielle et la mise en place de la Deuxième République.
La Révolution a certes libéré toute une partie de la société jugulée par Ben Ali depuis plus de trente ans, mais en assumer le relais s'est avéré une tâche difficile car, dès le départ du dictateur, les forces du changement se sont trouvées confrontées à une forte résistance des partisans de la continuité qui réseautaient encore tout le pays.
Pour pallier le vide institutionnel le Conseil Constitutionnel a désigné, au lendemain du départ de Ben Ali, Fouad Mebazaa, Président de la Chambre des Députés depuis 1997, comme Président de la République intérimaire, tandis que Mohamed Ghannouchi, ancien ministre de Ben Ali depuis 1987 et son premier ministre depuis 1999, a constitué avec d'anciens ministres RCD et deux anciens opposants, Nejib Chebbi et Ahmed Brahim un gouvernement qualifié abusivement de "gouvernement d'union nationale", investi le 17 janvier 2011.
La révolution n'avait pas de direction, et, en face, toutes les tentatives ont été faites pour assurer, par des mesures homéopathiques, la continuité de l'ancien régime: on a envisagé, conformément à l'ancienne Constitution, d'organiser des élections présidentielles dans les 60 jours suivant la fuite du dictateur, alors que le pays cherchait ses marques et que les partis de la résistance à la dictature ne disposaient ni de structures ni de moyens nécessaires pour participer à un quelconque rendez-vous électoral, aux conséquences pourtant majeures pour l'avenir du pays.
Plus tard, pour gagner du temps, on a même envisagé de conserver la Constitution de 1959, moyennant un "toilettage" qui la rendrait plus conforme aux standards internationaux.
En face, les partis de la résistance et la société civile ont pris le relais de la Révolution et se sont organisés autour de la centrale syndicale - l'Union Générale Tunisienne du Travail - et de l'Ordre National des Avocats. Au cœur de leurs revendications la nécessité d'une nouvelle Constitution s'est imposée, avec comme préalable l'élection d'une Assemblée nationale constituante. Cela est devenu le symbole du changement et le premier acte de fidélité aux martyrs de la Révolution de la Liberté et de la Dignité.
Cependant le nouveau gouvernement de Mohamed Ghannouchi a négligé le désir de changement qui submergeait toute la Tunisie et, tout au long des mois de janvier-février, un peu partout, des marches se sont organisées pour rompre avec l'ancien régime et ses symboles. Sous la pression de la jeunesse venue de tout le pays, soutenue par les partis politiques de la Résistance et une société civile très motivée, avec en pointe, notamment les syndicalistes et les avocats, des sit-in ont occupé la place du Gouvernement à La Kasbah, exigeant le départ du gouvernement jugé trop RCDiste et la dissolution de l'ancien parti de Ben Ali. Ils ont obtenu gain de cause à la fin du mois de janvier.
Le 18 février 2011, présidée par le professeur Yadh Ben Achour, était créée la Haute Instance pour la Réalisation des Objectifs de la Révolution, la Réforme Politique et la Transition Démocratique.
Elle a constitué un cadre où les partis et les représentants de la société civile ont été appelés à dialoguer et à définir, avec l'aide d'experts, les étapes indispensables pour mener le pays aux élections d'une Assemblée nationale constituante. Pour Yadh ben Achour il s'agissait d' "un processus para-gouvernemental et sociétal, acceptable et consensuel, de représentation et de décision". Outre l'élaboration d'un projet de code électoral excluant la participation des anciens responsables du régime déchu, cette instance a mis sur pied l'Instance Supérieure Indépendante pour les Élections -ISIE-, qui, sous la présidence de Kamel Jendoubi, grand militant droit-de-l'hommiste et ancien président du CRLDHT, a été chargé de superviser les élections.
Entre temps, comme les pressions populaires s'étaient accentuées sur un deuxième gouvernement remanié de Mohamed Ghannouchi, ce dernier doit démissionner le 27 février 2011 pour laisser sa place à Béji Caïd Essebsi, ancien ministre et ambassadeur de Bourguiba, ancien parlementaire RCD de 1989 à 1994, qui promet de former un gouvernement "sans appartenance politique" et d'organiser des élections pour une Assemblée Constituante.
Ainsi, le 3 mars, le Président de la République annonce l'organisation d'élections pour l'Assemblée constituante chargée d'élaborer la Constitution de la Deuxième République. La date initialement prévue du 24 juillet, est ultérieurement reportée au 23 octobre 2011 sur proposition de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Élections, En attendant, on procède à la dissolution des précédentes chambres des députés et des conseillers, du Conseil économique et social et du Conseil constitutionnel. La législation devra alors s'opérer par décret-loi. Le 22 avril, la cour de cassation de Tunis dissout définitivement le parti du Rassemblement Constitutionnel Démocratique (RCD).
Le 23 octobre 2011, le peuple tunisien se presse pour élire ses députés à l'Assemblée Nationale Constituante (A.N.C.). Cette journée mémorable symbolise la concrétisation du premier acte de changement majeur après la Révolution. Dans un climat passionné et une ambiance chaleureuse, les Tunisiens se sont rendus massivement pour accomplir leur devoir. Sous un soleil de plomb, bravant la chaleur, ils n'ont pas ménagé leur peine et ont souvent attendu des heures avant de voter et brandir avec fierté, à la sortie des urnes leurs index trempés d'encre bleue, preuve du devoir accompli.
Cependant une fois les urnes dépouillées, les résultats des élections ont été vécus comme une douche froide par les partis non islamistes. Si nous nous attendions à un score élevé d'Ennahdha - tous les sondages le plaçaient en tête -, en revanche, nous avons été totalement désarçonnés par la faiblesse des scores des autres partis politiques: aucun d'entre eux n'a atteint la barre des 10 % des voix. Le fait que ces élections aient consacré une forme d'hégémonie électorale et politique d'Ennahdha va rendre notre tâche plus difficile. D'autant plus que ma vie de militant a été fortement marquée par le "syndrome du parti unique".
Les résultats ont donc placé le parti islamiste Ennahdha, avec ses 89 sièges sur 217, très loin devant les partis de la Résistance: 29 sièges pour le CPR de Moncef Marzouki, 21 pour mon parti, Ettakatol, 16 pour le PDP de Nejib Chebbi. Curieusement, on note un score relativement élevé de 26 sièges, réalisé par des listes regroupées sous la bannière d'El Aridha (La Pétition), parti créé de toutes pièces par un milliardaire tunisien originaire de Sidi-Bouzid, établi à Londres et possédant une chaîne de télévision qui prônait un discours fortement imprégné de religiosité et de populisme.
Deux remarques s'imposent: d'une part, suite au trop grand nombre de partis et de listes créés dans l'euphorie de la chute de l'Ancien régime - 1517 listes dont 828 partisanes, 655 indépendantes et 34 de coalitions -, de nombreuses voix exprimées ont été "perdues", sans possibilité d'avoir de représentant à l'Assemblée. D'autre part, les zones rurales ont connu une forte abstention en dépit des efforts déployés par l'ISIE pour encourager les citoyens à s'inscrire sur les listes électorales.
On observe que les partis qui ont mené une campagne anti- Ennahdha, en focalisant leurs discours sur la question identitaire, ont été sanctionnés. Par exemple le Pôle démocratique moderniste de Ahmed Brahim n'a eu que 5 sièges; on note aussi une présence faible - 5 sièges - de ceux qu'on peut considérer proches de l'ancien régime et qui se sont présentés sous la bannière d'un nouveau parti Al Moubadara (L'Initiative).
Cependant ces élections n'ont pas été contestées. Partout, dans le monde elles ont été considérées comme une étape réussie et prometteuse dans le processus de transition, survenue après une année d'instabilité.
Ce blog fait partie d'une série de contributions de l'auteur sur "le processus transitionnel en Tunisie", qui seront publiées dans les jours à venir.
Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.